LE BUDGET D'UNE BANQUE - FORMATION -

Apprendre à préparer le budget d’un établissement bancaire
Le budget d’une banque est un document de planification financière qui regroupe l’ensemble des prévisions de produits et de charges sur une période de une année.
Le budget de la banque constitue un outil stratégique essentiel pour piloter l’activité, fixer des objectifs et garantir la rentabilité de l’établissement bancaire.
Pourquoi une procédure budgétaire dans une banque ?
La pérennité d’une banque et son développement dépend de son aptitude à anticiper l’avenir.
Pour maitriser les évolutions il faut :
- Prévoir les événements et non les subir
- Se doter d’une ligne d’action
- Passer d’un système où les résultats sont constatés à un système où les résultats sont programmés.
Le budget constitue l’instrument de prévision et de contrôle des résultats.
- Il est nécessaire de classer les charges similaires par grandes catégories;
- Recherche des coûts qui peuvent être classés sous ces dépenses;
- Faire des hypothèses de dépenses pour le programme;
- Etre attentif pour identifier les sources de recettes;
L’examen des informations disponibles
Toutes les estimations budgétaires trouvent leur origine dans quatre examens essentiels :
1 La projection des périodes précédentes. La comptabilité est la source d’informations majeure puisqu’elle fournit les indications sur le réalisé et les historiques.
2 Les conséquences qui résultent des stratégies de la banque et qui auront un impact significatif.
3 La conjoncture et les hypothèses.
4 L’analyse des écarts entre les prévisions budgétaires de l’année passée et le réalisé.
Le cadre budgétaire
On commence par établir une première projection désignée « le pré budget » en fonction des hypothèses envisagées (vers le mois d’aout)
Puis c’est le lancement de la procédure budgétaire dans l’ensemble de l’établissement. Cela commence par une lettre de cadrage qui rappelle les contraintes qui pèsent sur l’ établissement, les opportunités, les hypothèses pour l’année à venir.
| Budget d’exploitation | Recense les produits et charges liés à l’activité courante
|
| Budget d’investissement | Prévision des dépenses d’équipement, informatique, immobilier
|
| Budget de trésorerie | Planification des flux de liquidités, suivi des décaissements/encaissements
|
La préparation des budgets d’exploitation
Chapitre du PNI prévisionnel
Quels seront les volumes des crédits et les besoins de refinancement, les prévisions d’activités en particulier au niveau des ventes de crédit
A quel taux vendront nous ?
Aurons-nous de nouveaux produits ?
Quel sera le coût de rémunération de l’épargne ?
Chapitre des commissions
– Combien vont rapporter les commissions existantes
– Estimation des nouvelles commissions
Chapitre des frais de fonctionnement
– Les salaires prévisionnels et les charges sociales : les prévisions d’augmentation ou de réduction d’effectifs.
– Les frais généraux qui doivent être détaillés au niveau des grandes rubriques, les prévisions de frais généraux, incluant les prévisions d’augmentation de certains d’entre eux.
– Les impôts et taxes tels qu’ils sont envisagés pour l’année à venir.
– Les dotations aux amortissements
Chapitre du coût du risque
- L’évolution de la conjoncture économique : Incorporer les scénarios macroéconomiques (croissance, taux d’intérêt, taux de chômage, secteurs en difficulté)
- Nos risques spécifiques par rapport à nos concours en tenant compte de nos taux de défaut et taux de recouvrement des dernières années
- Le calcul du coût du risque prévisionnel se fait par nature de crédit en fonction de l’historique des défaillances et des risques probables pour l’année à venir.
- Le risque opérationnel résultant des fraudes, erreurs, pannes, litiges. Le coût du risque opérationnel se calcule selon les approches réglementaires (Bâle 2 et Bâle 3) ainsi qu’avec les méthodes internes de la banque.
Chapitre des investissements
- Les investissements informatiques
- La création d’agences nouvelles
- La stratégie d’investissements de la banque
- Les autres investissements
Chapitre du financement
- Quels emprunts, quand les lancer avec estimation des taux
- Les accords de financement obtenus et les échéances des remboursements des prêts en cours.
La période des arbitrages commence par la consolidation des budgets .
S’il apparait des anomalies lors de ce travail préparatoire, on recommence en faisant varier l’une des variables.
Le processus est ainsi itératif, jusqu’à l’obtention des résultats voulus.
Le suivi budgétaire
Chaque mois ou chaque trimestre, selon la périodicité souhaitée par la banque, le contrôleur de gestion analyse l’exécution du budget et détermine des écarts par rapport aux prévisions.
Parallèlement, il effectue le reporting sous la forme de rapports trimestriels sur l’exécution du budget en indiquant les principales constatations et en formulant des recommandations.
Tous les trimestres, les valeurs réellement constatées sont comparées avec les prévisions budgétaires.
Les écarts sont analysés avec les responsables des centres budgétaires afin de rechercher leur cause, les éventuelles responsabilités, les moyens à envisager pour se rapprocher des objectifs initiaux.
L’école de la microfinance propose des formations spécifiques pour les contrôleurs de gestion des banques http://www.ecole-de-la-microfinance.com
A PROPOS DE L’ECOLE DE LA MICROFINANCE
La segmentation de la clientèle dans les banques
Les objectifs de la segmentation dans les établissements bancaires sont les suivants :
- La segmentation permet de mieux connaître les demandes d’un segment de clientèle précis. En principe ce ne sont pas les mêmes commerciaux qui s’occupent de tel ou tel segment.
- La segmentation permet de proposer des produits et services adaptés à chaque type de clientèle (salariés, agriculteurs, commerçants, PME…)
- En répondant mieux aux besoins de la clientèle avec des produits et services adaptés, on fidélise mieux les clients
- Avec la segmentation, les opérations commerciales peuvent ne s’adresser qu’à une seule strate de clients et non à l’ensemble de la population ce qui permet d’avoir de meilleurs retours.
- On peut aussi améliorer la compétence du risque des agents grâce à la segmentation, car une partie du personnel se spécialise sur un segment et le connait très bien.
Exemple de segmentation dans une banque :
Segment S1: Les patrimoniaux : cadres supérieurs, les professions libérales forts consommateurs de produits financiers.
Segment S2 : Les salariés, les consommateurs moyens, clients à potentiel stable, non risqués, rentables.
Segment S3 : faibles consommateurs, proposer des produits simples, à maintenir et à équiper.
Segment SJ : Les jeunes, de moins de 25 ans investir sur ces clients à potentiel dans le futur.
Segment SN : Les clients ayant moins de 1 an ancienneté à développer et à équiper.
Segment PRO : les professionnels – artisans et commerçants – (moins de 5 millions de CA et moins de 10 salariés)
Segment ENT : les entreprises de plus de 5 000 000 de CA ou de plus de 10salariés
Segment GME : les grandes entreprises à envergure nationale. Ce segment sera suivi par des chargés d’affaires.
Segment AGRI : les agriculteurs
Segment ASSO : les associations OBNL avec budget > 1,5 M€ et/ou + 3 salariés
Le besoin de segmentation dans les banques
Face à des marchés bancaires très divers – marché des particuliers, marché des entreprises, marché des agriculteurs, marché des associations, marché des investisseurs institutionnels, marché des collectivités territoriales – et à des clients aux besoins et aux caractéristiques hétérogènes, la banque ne peut pas proposer un produit unique pour l’ensemble de ses clients potentiels.
Il est donc nécessaire de segmenter la clientèle afin que chaque groupe puisse trouver dans la banque les produits qui sont adaptés à ses activités.
En quoi consiste la segmentation en banque ?
La segmentation consiste simplement à répartir l’ensemble des clients et prospects en un certain nombre de sous-ensembles du marché qui présentent des caractéristiques homogènes. On peut par exemple dans certains établissements avoir un segment « jeunes » pour la clientèle de particuliers qui commence à travailler sans être encore chargée de famille ou un segment « fonctionnaires » pour une clientèle qui disposera de revenus réguliers et peut s’endetter pour l’acquisition d’un bien.
Comment pratiquer la segmentation ?
Il faut prendre l’ensemble du fichier client et indiquer en informatique à l’aide d’un code à quelle strate de clientèle il est rattaché.
Le traitement peut être automatisé si les informations ont été collectées lors de l’entrée en relation ou lors des demandes de crédit et sont présentes dans les fichiers informatiques
Ainsi tout client sera rattaché à un segment et il sera possible de spécialiser la force de vente sur le segment.
L’intérêt de la segmentation pour une banque
Une fois qu’on a identifié des familles homogènes de clients, il va être possible d’appliquer des stratégies de conquête et de fidélisation proposer à cette clientèle. Par exemple si j’ai un segment de clientèle répondant à la notion de patrimoniaux, je vais m’intéresser très spécifiquement à des financements immobiliers, à des placements rémunérateurs en tenant compte de façon particulièrement précise de la fiscalité propre à cette clientèle…
Les buts de la segmentation vont être :
1 de mieux communiquer avec la clientèle du segment que la banque va mieux connaitre et pour laquelle elle va spécialiser ses commerciaux.
2 de définir une politique commerciale spécifique pour le segment, en obtenant ainsi un avantage concurrentiel évident par rapport aux établissements concurrents.
3 de créer des produits propres à la clientèle du segment qui répondent au mieux aux besoins spécifiques.
4 et en définitive d’optimiser le dispositif commercial de la banque
Les qualités d’un segment pour un établissement bancaire
- Pour commencer un segment doit être substantiel c’est-à-dire capable de générer des flux importants pour la banque. On ne peut pas retenir un segment trop étroit.
- Un segment doit être rentable pour la banque. On ne peut pas investir dans la création de produits spécifiques si la clientèle potentielle est incapable de payer les services proposés.
- Un segment doit aussi être homogène. Par exemple si l’âge est un déterminant pour la segmentation d’une banque il n’y aura aucune ambiguïté à entrer un client dans le segment simplement en regardant l’âge du client. Il en va de même de quantité de critères très précis comme la tranche de revenus pour les particuliers, le sexe, le CA pour les entreprises…
- Un segment doit correspondre à une façon bien précise de consommer les produits bancaires. Ce sera bien le cas pour un segment des très petites entreprises qui recherchent un accompagnement ou pour un segment des salariés dont les préoccupations tourneront autour de la constitution de leur patrimoine et l’achat de leur logement.
- Un segment peut aussi se constituer par rapport à la proximité d’un évènement. Le segment des futurs retraités permet à la banque de proposer des produits spécifiques de capitalisation afin pour le client qu’il puisse dès qu’il sera effectivement en retraite disposer d’un complément de revenus.
- Un segment de clientèle doit aussi pouvoir être atteint en termes de publicité et de supports de communication clairement identifiés ou de marketing direct.
- Un segment doit être mesurable car on voudra suivre sa pénétration à travers l’évolution des parts de marché sur le segment.
L’ÉCOLE DE LA MICRO-FINANCE est un organisme de formation français spécialisé dans l’enseignement des métiers de la microfinance.
Il est indispensable, pour faire fonctionner correctement une institution de microfinance , de disposer d’un personnel compétent, de cadres et d’administrateurs qualifiés, capables de gérer les programmes de façon professionnelle.
L’école de la microfinance a été créée par des professionnels de la banque et de la microfinance, dans le but de professionnaliser les acteurs du secteur .
L’école de la microfinance est aujourd’hui l’un des principaux organismes en matière de formations aux métiers de la microfinance dans les pays francophones.
FORMATION DU DIRECTEUR D’AGENCE EN BANQUE
L’école de la microfinance forme des directeurs d’agences bancaires
Le métier de directeur d’agence bancaire consiste à gérer une équipe, développer la clientèle, assurer la rentabilité de l’agence et respecter les réglementations bancaires.
C’est un poste à responsabilité qui allie management, commercial et expertise financière.
Le directeur d’agence bancaire a un rôle essentiel : il est un véritable manager, un commercial et un gestionnaire de ressources humaines.
C’est dans ce cadre que l’école de la banque et de la microfinance organise un parcours de formation d’une durée de 10 jours consécutifs permettre aux futurs directement d’agences bancaires de prendre leurs postes dans les meilleures conditions.
La formation du directeur d’Agence permet de maitriser :
- La gestion d’un portefeuille clients.
- Le développement commercial.
- Le management d’équipe.
- Le suivi des risques et de la conformité réglementaire.
Programme type de la formation du Directeur d’agence bancaire
Les compétences clés à développer au cours de la formation
- Techniques : produits bancaires, crédits, épargne, assurance, gestion des risques.
- Management : encadrement d’équipe, motivation, pilotage d’objectifs.
- Commerciales : négociation, fidélisation, développement de la clientèle.
- Transversales : communication, sens de l’organisation, esprit d’analyse.
Le programme détaillé de la formation du directeur d’agence bancaire
A quoi sert une banque ?
1 Le rôle de la banque dans l’économie
2 Les banques apportent des services spécifiques.
3 la banque a un rôle de 0conseiller pour la clientèle
Développer la clientèle de l’agence bancaire
1 Prospecter avec les techniques de marketing direct
2 Élargir la base des clients et des prospects
3 Bien entendre ce que nous disent nos clients qui sont partis.
L’analyse du dossier crédit entreprise individuelle en agence
1 L’analyse d’une demande de prêt pour un particulier
2 L’analyse d’une demande de prêt pour une entreprise.
3 Argumenter un dossier crédit
L’analyse du dossier crédit au service des engagements au siège ou en direction régionale
1La vérification du dossier crédit
2 L’analyste Risques-Engagements est le garant de l’application de la politique des risques en matière de crédits.
3 Le service des engagements utilise des données Internes et externes pour aider à la décision.
Le recouvrement en banque
1 Le traitement des impayés clients en banque par le chargé de clientèle
2 Les procédures amiables : solutions simples et courtoises
3 Les procédures contentieuses
L’épargne et la collecte des dépôts
1 Bien comprendre les rôles de l’épargne
2 Les produits d’épargne
3 Comment collecter une épargne stable
L’organisation d’une agence bancaire
1 La structure de l’agence
2 Le fonctionnement de l’agence
3 Le guichet
La cartographie des risques en agence bancaire
1 La cartographie des risques dans une agence bancaire
2 Savoir mesurer les risques à partir de leur impact maximum et de la probabilité de réalisation du risque
3 Comment se protège-t-on des risques ?
Faire de votre agence bancaire l’établissement de référence
1 Les actions commerciales
2 Les actions commerciales de l’agence
3 Mettre l’agence au cœur de son marché
Les résultats de l’agence, le budget de l’agence bancaire
1 La banque est composée d’agences et de services du siège
2 Le PNI – Produit net d’intermédiation – de l’agence
3 Les résultats de l’agence
Le management dans mon agence bancaire
1 Profession Chef d’Agence
2 Faire le diagnostic de mon agence forces, faiblesses, opportunités, menaces.
3 Diriger l’agence
La sécurité des biens et des personnes en agence bancaire
1 La sécurité du point de vente
2 La prévention
3 La sécurité informatique de l’agence
Prévenir les fraudes
1 Check list CAC des risques de fraudes
2 Les fraudes aux crédits
3 La prévention du blanchiment et du financement du terrorisme.
La réglementation bancaire
1 Les organismes de tutelle et de contrôle
2 La réglementation baloise
3 Des normes internationales
La gestion des ressources humaines décentralisée en Agence, la motivation
1 Rôle et limites de la gestion des ressources humaines dans l’agence
2 Le développement des ressources humaines
3 Les managers de proximité sont les moteurs de la motivation
Le contrôle interne dans une agence bancaire
1 L’organisation du contrôle dans les banques s : autocontrôle du titulaire du poste, contrôle hiérarchique dit de premier niveau, contrôle par des contrôleurs (second niveau) et missions d’audit (troisième niveau).
2 Les contrôles spécifiques des entrées en relation, des fiches de connaissance des clients, des dossiers de crédits.
3 Le contrôle interne a pour objet de réduire les risques.
La clientèle entreprises TPE / PME
1 Bien comprendre les besoins de financement des entreprises
2 Étudier le risque d’une entreprise à l’aide de ses documents comptables
3 Appuyer l’analyse du dossier crédit sur la comptabilité de l’entreprise ou sur la reconstitution des documents comptables
|
|
LES GARANTIES EN BANQUE
En banque, les garanties sont des dispositifs que l’établissement financier exige pour se protéger contre le risque de non-remboursement lorsqu’il accorde un crédit ou facilite une opération.
Elles servent à sécuriser la créance : si l’emprunteur ne respecte pas ses engagements, la banque pourra saisir un bien ou obtenir un remboursement via un tiers.
En quoi consiste une garantie bancaire ?
En octroyant un prêt, la banque court le risque de n’être pas remboursé par l’emprunteur.
Pour se couvrir les banques prennent des garanties qui vont couvrir la totalité ou une partie de la perte finale de la banque (ou d’un organisme de financement) aura en cas de défaillance de l’emprunteur.
Les garanties peuvent être des garanties personnelles, des garanties portant sur une chose (garantie réelle)
Les Sociétés de Cautions Mutuelles sont des établissements de crédit constitués en sociétés coopératives. Leur objet est d’apporter une garantie bancaire à leurs membres soit en garantissant directement l’emprunteur auprès de la banque, soit en contre-garantissant la banque qui prend le risque.
La garantie est alors octroyée moyennant une commission payée directement par la banque ou par l’emprunteur.
La banque demande une garantie avant l’octroi du prêt
Le processus de mise en place des crédits consiste en un examen du projet présenté par le demandeur mais aussi en un examen des garanties proposées.
Dans une banque, le chargé de clientèle est l’interlocuteur principal des clients.
Par rapport à une demande de prêt, son rôle est de conseiller et éventuellement de prendre la décision de refuser les projets incohérents, ou non rentables pour l’emprunteur ou encore inadaptés.
La nécessité de protéger la banque pour les cas de défaillance de l’emprunteur oblige la banque à prendre une garantie (hypothèque, titre foncier, caution…).
La banque peut également se couvrir de certains risques de défaillance (dans le cas du décès ou de la perte totale et irréversible d’autonomie, de l’invalidité, et parfois de la perte d’emploi.) via une assurance emprunteur qui prend en charge le paiement de tout ou partie des échéances de remboursement du crédit restant dû.
1 Le rôle des garanties, les grands types de garantie
A L’utilité d’une garantie :
Les garanties sont les moyens juridiques qui sont accordés au créancier par la Loi, par une décision de justice ou par la convention des parties aux fins de garantir l’exécution d’obligations préalables et de se prémunir contre le risque d’insolvabilité du débiteur.
B classification des garanties
La garantie est un contrat qui permet d’optimiser les chances de recouvrer les créances des banques, en leur conférant une priorité parmi les créanciers suivant la garantie et son rang.
On distingue des garanties personnelles (l’engagement d’une personne) et des garanties réelles (portant sur une chose)
Les garanties personnelles
– Personne physique ou morale qui engage sur tout ou partie de son patrimoine (biens et revenus) pour garantir les engagements d’une autre personne (le débiteur).
Elle peut prendre la forme d’une caution, d’un aval ou une d’une lettre d’intention
Les banques peuvent demander des garanties personnelles. Il s’agit d’un engagement donné par un tiers qui garantit que l’emprunteur paiera bien ses échéances en se portant caution. En cas d’échéance impayée, la banque peut se retourner automatiquement sur la caution.
Les garanties reelles
Il s’agit souvent de gages ou divers formes de garanties matérielles qui sont consenties à la banque avec dépossession (la mise en gage d’un objet important pour le demandeur et facile à vendre pour la banque) ou sans dépossession (le nantissement).
2 Les garanties personnelles (ou sûretés personnelles)
A Le cautionnement
Définition
Le cautionnement est un contrat par lequel un tiers, appelé caution, s’engage envers le créancier à exécuter l’obligation du débiteur principal si celui-ci n’y satisfait pas lui-même.
Caractéristiques
Le cautionnement est :
Accessoire à l’obligation principale : il est donc lié au contrat principal
Unilatéral : il n’est signé que par celui qui cautionne
Le débiteur obligé à constituer une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter et présenter des garanties de solvabilité pouvant répondre de l’objet de l’obligation.
La solvabilité d’une caution s’apprécie en tenant compte de tous les éléments de son patrimoine.
B La caution solidaire
Personnel :
La garantie porte sur l’ensemble des biens et revenus de la caution
La loi sur la réforme des sûretés abolit la notion de caution réelle (portant sur un bien précis de la caution). Elle autorise donc une personne physique ou morale à apporter un bien en garantie des engagements d’un tiers, sans que le lien de cautionnement soit obligatoire
La caution peut garantir son engagement en consentant une sûreté réelle sur un ou plusieurs de ses biens.
Elle peut limiter son engagement à la valeur de réalisation du ou des biens sur lesquels elle a consenti une telle sûreté.
Le bien apporté en garantie est un meuble.
(Ex gages, compte à terme …)
– L’acte de garantie sera signé directement par le garant sans indication d’un quelconque lien de cautionnement.
– Si l’on souhaite élargir le périmètre des garanties, il y a lieu de recueillir par acte séparé une caution personnelle et solidaire qui permettra d’agir sur l’ensemble des biens.
C Effets du cautionnement
L’effet principal du cautionnement est de permettre au créancier de réclamer paiement à la caution en cas de défaillance du débiteur.
La caution dispose aussi d’un recours contre le débiteur principal pour obtenir le remboursement de ce qu’elle a dû verser ; et, en cas de pluralité de cautions, celle qui a désintéressé le créancier dispose d’une action récursoire contre les autres créanciers.
3 Les garanties réelles (ou sûretés réelles)
Elles portent sur un bien précis.
Si l’emprunteur ne paie pas, la banque peut saisir et vendre ce bien.
- Le nantissement : gage sur un bien meuble (compte-titres, fonds de commerce, assurance-vie…).
- Le gage : dépôt d’un bien physique (bijoux, véhicules, marchandises…).
- Le privilège de prêteur de deniers (PPD) : spécifique à l’achat immobilier, moins coûteux qu’une hypothèque.
- L’Hypothèque : prise sur un bien immobilier.
1 Le nantissement
- Le gage est la remise en garantie d’un bien meuble corporel
- Le nantissement est la remise en garantie d’un bien meuble incorporel
Il existe toutefois une exception à cette règle qui concerne la remise en garantie DES MATÉRIELS ET OUTILLAGES, bien que classés dans la catégorie des meubles corporels, sont traités dans le cadre des nantissements
2 Le gage
Il existe des gages avec dépossession et des gages sans dépossession :
– Le gage avec dépossession :
Le propriétaire du bien s’en dessaisit, ce qui implique pour le créancier gagiste l’obligation d’en assurer la conservation dans des conditions optimales
– Le gage sans dépossession :
Une inscription sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce permet de savoir que le bien est gagé.
Le prêt sur gage
Création de ce type de prêts au Mont de Piété en 1642 à Pérouse
Le principe est d’octroyer un crédit au vu du dépôt d’un objet, d’or ou d’un bijou. La question la plus délicate consiste à évaluer le bien remis en garantie.
En France le prêt sur gage est un monopole d’état afin de lutter contre les pratiques des usuriers. Le crédit Municipal a hérité des Monts de Piété.
Le dossier de demande de prêt est très simple puisque l’emprunteur doit juste donner son nom et son adresse. L’établissement prend une photo de la carte d’identité.
3 Le privilège du prêteur de deniers ;
La garantie du prêteur de deniers (PPD) est une garantie inscrite sur un immeuble donnant le droit à celui qui a prêté tout ou partie des fonds nécessaires à l’acquisition dudit immeuble, d’être préféré aux autres créanciers.
Prévue au profit des seuls établissements de crédit qui consentent des crédits destinés à l’acquisition d’un immeuble existant, cette garantie couvre le capital du prêt et jusqu’à 3 ans d’intérêts.
En cas de défaillance de l’emprunteur, l’établissement prêteur peut obtenir la vente de l’immeuble, et se faire payer sur le prix de la vente, avant tout autre créancier, hypothécaire inclus.
Le privilège de prêteur de deniers doit faire l’objet d’un acte notarié et être inscrit à la Conservation des hypothèques dans les 2 mois suivant la vente.
Le PPD présente l’avantage d’être infiniment plus avantageux puisqu’il n’est pas soumis à la taxe de publicité foncière.
4 L’hypothèque : garantie traditionnelle ;
Son coût est élevé (taxe de publicité foncière et frais d’enregistrement au Bureau des hypothèques).
L’inscription se fait au registre de la conservation des Hypothèques du lieu de situation de l’immeuble. Cette publicité la rend opposable aux tiers. Elle prend rang au jour de son inscription.
L’hypothèque est obligatoirement constituée par acte authentique (notarié). C’est le notaire qui procède à son inscription.
Les autres formes de sécurité pour la banque
-
Assurances emprunteur : couvrent certains risques (décès, invalidité, perte d’emploi).
-
Cession de créances : la banque prend la main sur les revenus futurs (ex. : cession Dailly pour les entreprises).
-
Fiducie-sûreté : transfert temporaire de propriété d’un bien à la banque jusqu’au remboursement complet.
Le contrôle de gestion en banque
L’école de la microfinance propose une formation au contrôle de gestion bancaire destinée aux contrôleurs de gestion récents dans la fonction ainsi qu’aux dirigeants, cadres de banques, informaticiens et comptables, en relation avec le contrôle de gestion dans les établissements bancaires.
En quoi consiste le contrôle de gestion en banque ?
1 L’analyse de la performance globale de la banque
L’analyse du compte de résultat à travers les évolutions des soldes intermédiaires de gestion : évolution du PNI ‘produit net d’Intérêts) du PNB (Produit Net Bancaire) des frais de fonctionnement, du cout du risque, le RBE (Résultat brut d’Exploitation)
La présentation d’une analyse financière mettant en évidence les évolutions de l’exploitation, les forces et les difficultés de la banque à travers les calculs des ratios de rentabilité, le calcul du coefficient d’exploitation, le rendement des actifs ou ROA (Return On Assets), le rendement des fonds investis ou ROE (Return On Equity), le calcul des taux de production des crédits, des taux moyens d rémunération d l’épargne.
2 Le suivi de la performance commerciale des agences
Il est fondamental de savoir calculer ls résultats de chaque agence de la banque. Chacun a en effet un mode de fonctionnement spécifique, certaines agences collectent plus de ressources qu’elles ne font d crédit. Pour d’autres c’est l’inverse aussi le contrôle de gestion doit mettre en place un système où le siège devient la banque des agences lesquelles empruntent ou reversent des intérêts sur le compte au siège. Le taux d’intérêts utilisé pour ces échanges est le TCI (taux de cession interne)
3 L’élaboration des budgets, des plans d’actions
Dans une banque, le contrôleur de gestion a la charge d’élaborer les budgets et de chiffrer les plans d’actions. Des agences et des services du siège. L’élaboration des budgets et la définition des plans d’actions
4 Le tableau de bord
Le contrôleur de gestion est chargé de l’élaboration du tableau de bord de la banque et de la mise à jour de l’ensemble des indicateurs de la banque.
Ces informations seront précieuses pour les dirigeants de la banque pour permettre des prises de décision.
| Objectifs : | Situer le rôle, les missions et l’organisation du contrôle de gestion dans une banque.
Être en mesure de fournir à la direction générale les informations nécessaires au pilotage stratégique et opérationnel de l’établissement. Mesurer la performance bancaire, préparer les outils nécessaires au pilotage opérationnel, à la prévision, à la programmation des actions. Connaitre les procédures permettant la préparation du budget sur la base des principaux objectifs fixés par la direction, de la conduite de la stratégie de la banque. Maitriser l’élaboration d’un tableau de bord pertinent.
|
| Programme : | 1 Les missions et l’organisation du contrôle de gestion bancaire
2 La mesure de la rentabilité 3 Le processus d’élaboration budgétaire 4 Les résultats de l’agence, le budget de l’agence 5 La comptabilité analytique, la mesure des coûts des services et produits bancaires 6 Le suivi statistiques des encours 7 Le tableau de bord de gestion et les indicateurs 8 La cartographie des risques 9 La performance (SIG et grille d’analyse 2 pages) 10 L’utilisation des ratios pour l’analyse financière |
| Méthodes et outils | Exposés, cours et exercices. Échanges.
Nombreuses études de cas pratiques de banques Travaux en sous-groupes. Mises en situation. Remise d’un support de cours complet et documenté. |
| Durée de la formation en centre : | La formation en présentiel au contrôle de gestion bancaire se fait sur 5 jours soit 35 heures |
| Prérequis : | La promotion interne, après quelques années d’expérience, est la voie d’accès la plus courante pour accéder au poste de contrôleur de gestion en banque.
Pour suivre le stage il est recommandé d’avoir de bonnes connaissances en comptabilité générale, en statistiques et de connaitre la finance. |
| Prestations annexes : | L’école de la microfinance offre la possibilité de formation par e-learning :
L’enseignement de l’école de la microfinance s’appuie sur un cours à distance autosuffisant qui couvre l’ensemble du programme de l’unité d’enseignement. |
L’école de la microfinance a obtenu la certification qualité Qualiopi pour la qualité de ses prestations.
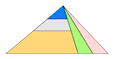 L'école de la microfinance
L'école de la microfinance

